Rencontre au Sommet, de Paulette Spescha-Montibert
Voici un texte inédit de la poétesse Paulette Spescha-Montibert dont nous avions déjà publié quelques poèmes de Corée dans le numéro 7 des Cahiers de Corée.
RENCONTRE AU SOMMET
Aujourd’hui, 15 août, dans le village de mon enfance, a lieu depuis la nuit des temps, le pèlerinage « à la Madone ». Ma famille sera réunie là, au sommet de la colline. Laissant mes pensées s’envoler vers mon Beaujolais natal, je décidai de m’octroyer une journée de congé et de partir marcher dans la montagne.
La montagne s'appelait Bukhansan.
J'avais attendu dix heures du matin afin d’éviter la monstrueuse circulation dans la gigantesque ville de Séoul pour, au volant de ma petite auto, m'approcher le plus possible du pied de la montagne. Pour cela, il m'avait fallu traverser le centre ville, de nombreux tunnels, plusieurs faubourgs, atteindre les premières rizières, franchir un contrôle militaire, longer une rivière, gravir une colline et enfin garer ma voiture à proximité d'un restaurant champêtre, là où d’ailleurs la route s'arrête.
A quelques mètres du parking, sur un bout de rocher, un petit temple avait ses portes grandes ouvertes. A l'intérieur, on pouvait voir briller des bougies et étinceler trois statues, totalement identiques, d'un Bouddha doré assis en lotus. Un homme qui descendait l’escalier taillé à même la pierre, se retourna une dernière fois en direction du lieu saint et, mains jointes, se courba respectueusement puis vint vers moi.
L'homme m'accueillit d'un large sourire, s'inclinant à plusieurs reprises. Je fis de même et, en réponse à ses salutations : « Siksa hasyeosseoyo ? », lui souhaitai de recevoir aujourd'hui sa portion de riz. Sac au dos, bâton en main, j'attaquais ensuite la montée rocailleuse qui devait me conduite à Sangunsa, un temple situé à environ une heure de marche, lorsque la voix d'une fillette m'invita à me retourner. J'entrais justement sous la feuillée. L'enfant, inondée de soleil, me faisait un petit signe de la main, souhaitant elle, que la paix soit avec moi: « Annyeong haseyo, annyeong haseyo ». La fillette était resplendissante, ses yeux seuls souriaient et sa voix chantait.
Ce 15 août allait en effet me procurer et riz et paix. Riz qui me serait, comme à tout visiteur du temple, offert à l'heure du déjeuner et paix tout au long de la journée passée en pleine nature avec le silence, les oiseaux, et tout là haut, en compagnie d'un homme qui allait devenir un ami : Sungjong Seunim, le prieur ; en fait le seul et unique moine résidant à Sangunsa.
En traversant la forêt, je rencontrai peu de monde sur le sentier escarpé. Ici et là une personne seule. A deux reprises un couple avec bébé endormi, une joue écrasée au dos de sa jeune maman. Avant de les croiser, j'entendis trois dames, plus très jeunes, qui descendaient riant et sautillant comme des adolescentes. Elles furent surprises de me rencontrer, ralentirent le pas, baissèrent un instant la voix puis reprirent leur descente rapide en chantant. Je fis halte à mi-chemin et à la faveur d'un avancement de rocher m'attardai quelques instants à regarder la vallée, c’est-à-dire la ville. La montagne étant plantée au cœur de la capitale, Bukhansan et Séoul ne font qu’un. Loin dans le bas, voilée par un nuage de pollution, l'on apercevait une de ces effrayantes banlieues, vraies forêts de gratte-ciel qui, petit à petit, s'agglutinent à Séoul, ville dont le nombre d'habitants ne tardera pas à atteindre les douze millions.
La montagne elle, reste belle et pure. Je repris mon ascension.
Un homme, pour annoncer sa venue et me dépasser sur l'étroit sentier, fit claquer sa canne à un tronc d'arbre. Bien que marchant vite, il prit le temps de me saluer et un peu plus loin, malgré la lourde charge qu'il portait sur le dos, de se baisser pour ramasser un caillou qu'il ajouta au monticule érigé sur le côté du chemin. Arrivée à la hauteur du bien précaire monument, je déposai, tout comme lui, une pierre plate, aidant ainsi une âme à gagner le paradis. L'homme à la canne n'était déjà plus en vue ; sans doute avait-il l’intention d’arriver au temple pour le service que j'entendais, annoncé par le battement du « moktak ».
Le moktak est un bel objet de bois en forme de gland qui possède une anse taillée dans la masse même. C'est par cette anse-poignée que l'instrument est tenu d'une main pendant que de l'autre, le moine ou la moniale, frappe plusieurs coups, parfois des dizaines, des centaines de coups, à intervalles plus ou moins longs, s'aidant d'un bâtonnet court et massif. Le son du moktak varie selon le message à communiquer, un peu d'ailleurs comme le font nos cloches. Il est aussi utilisé pour scander les prières et mantras récités par les religieux durant les services au temple. Lorsqu'il accompagne les chants profonds et envoûtants des moines, le moktak devient instrument de musique capable de vibrer, de faire vibrer, et les voix et les âmes. Si le promeneur en balade dans la montagne entend le toc toc toc de cette cloche de bois et oriente ses pas en sa direction, il est assuré de trouver un temple bouddhiste, son gardien - moine ou moniale – à moins que ce ne soit une communauté entière. Là, il se verra offrir un bol de riz et une tasse de thé. Si ce même tintement résonne dans les couloirs du métro ou au coin d'une allée de Dongdaemun, le gigantesque marché couvert de Séoul, l'on sait qu'un religieux demande aumône, accomplissant peut-être son année de mendigot.
Lorsque j'arrivai sur le plateau où repose Sangunsa, le toc toc toc résonnait encore. A l'intérieur de l'édifice principal, où là aussi les portes étaient grandes ouvertes, je discernai quelques personnes prosternées, front au sol et le Seunim Sungjong qui battait le moktak, se courbant, se relevant à chaque récitation de ce qui me semblait être une courte invocation, un mantra peut-être, répété de multiples fois.
Désireuse de ne pas déranger l'office, je me dirigeai vers un bâtiment tout de pierres, situé un peu en retrait et auquel l'on accède par un escalier également de pierres. Pas de chaussures déposées à l'extérieur, donc personne dans ce petit temple dédié au Bouddha guérisseur. Là, le soleil entrait à flots faisant miroiter le sol couvert du traditionnel papier vernissé, jaune safran. Je pris un coussin sur la pile bien rangée et, avant d'aller m'asseoir dans l'ombre, allumai un bâton d'encens que je piquai au centre d'un grand bol de cuivre rempli de cendre fine et où plusieurs bâtonnets finissaient de se consumer en dégageant une agréable odeur de santal.
J’allais, quelques mois plus tard, apprendre qu’en ce lieu, bouddhisme et taoïsme se mêlent. J'aimais la rudimentaire statue de pierre d'un Bouddha assis, un galet blanc gros comme un œuf, dans la coupe de ses mains qui reposaient au creux de ses genoux repliés. Le lieu était très fréquenté, surtout par des bouddhistes fervents : témoins les coupes et les corbeilles disposées sur l'autel regorgeant de riz et de fruits ; prodigalité constatée à chacune de mes visites et en toutes saisons.
Sur l'autel où trônait le Bouddha guérisseur, tout à côté mais cependant un peu en retrait se trouvait une immense toile représentant une scène que je croyais alors appartenir au chamanisme, où l'on pouvait voir un vénérable vieillard enveloppé d'un ample vêtement gris et d’une large écharpe rouge bordée de noir. Les doigts de sa main gauche égrenant les perles de son « mâlâ ».
L’homme, je l’appris par la suite, n’était autre que « Chisongzi », le célèbre maître de la pluie du taoïsme, plus connu en Corée sous le nom de Vénérable Naban ou Sudeok, autre appellation traditionnelle, signifiant en coréen « Vertu des Arbres ». Ce Sage aux yeux rieurs était assis près d’un rocher et d’un grand arbre, un pin au tronc tourmenté. En arrière plan, des montagnes escarpées, rapprochées, souvent rencontrées en peinture orientale et entre lesquelles se déversent torrents et cascades. Un serviteur, homme ou femme, en costume traditionnel coloré se dirigeait vers le vieillard les bras chargés d’offrandes. Le vieil homme à cheveux blancs respirait la bonté et la sérénité, je le pensais tout à fait capable de négocier avec les esprits qui hantent les forêts et les montagnes ; j'entends les mauvais esprits, ceux qui descendent jusqu'aux villes et villages, tourmentent le cœur des hommes et leur occasionnent malheurs et maladies. Rien de plus naturel donc que de trouver ce tableau dans le voisinage du Bouddha guérisseur. Les deux déités semblaient d’ailleurs faire bon ménage et c’est sans doute la raison pour laquelle Sungjong Seunim, qui certainement n'ignorait pas que Chisongzi appartenait au panthéon d’une tradition autre que la sienne, non seulement en tolérait la présence mais en assurait l'entretien.
N'entendant plus aucun chant, je m'avançai vers le bâtiment principal empruntant une allée garnie de fleurs au bout de laquelle, à quelques mètres de l’entrée du sanctuaire, se trouvait un puits, la margelle entourée de gobelets mis à la disposition des visiteurs.
Je déposai mes chaussures de marche et entrai dans le temple. Là, une femme assise jambes croisées, genoux à terre, dos parfaitement droit, priait en silence. L'on ne pouvait que voir défiler les perles du chapelet sur lequel ses doigts glissaient à grande vitesse. Si sa prière semblait n'avoir que quelques syllabes, son chapelet, lui, devait avoir plusieurs mètres de long. Je choisis de m'asseoir un peu à l'écart, disposant un coussin dans l'ombre. Je pensais n’avoir fait aucun bruit mais la femme, sans interrompre ses prières, et tout en se glissant sur le sol de bois vernis, vint, sans se retourner, mettre à ma disposition quelques dizaines de centimètres de perles de son chapelet. De gré ou de force, je me trouvais bien obligée de prier au rythme accéléré de cette pieuse dame.
Sur l'autel central trois Bouddhas dorés de grande taille trônaient, assis en lotus. L'on aurait pu les croire identiques mais la position des mains disposées en des mudras différents indiquait que l'un était la représentation du maître enseignant : une main posée ouverte au creux du drapé de son vêtement, l'autre montrant de son index pointé à terre que c'est de la vie au quotidien, bien sur terre, dont il voulait parler. Un autre Bouddha, une main en coupe, l'autre levée, pouce replié, disait « aie confiance ». Au centre, le troisième Bouddha, les mains en coupe reposant l'une dans l'autre ne voulait rien nous dire.
Tout avait été dit. Il méditait et la sérénité de son visage reflétait l'immense paix qui l'habitait. En dessous des trois déités, de vastes coupes débordaient de sucreries et de fruits. A terre, plusieurs corbeilles regorgeaient de légumes, de thé, de riz, de poissons secs, d'orge grillée, d'algues compressées, de sel, d'huile, et cela en un lieu auquel l'on ne pouvait accéder qu'à pied et au prix de maints efforts.
En sortant de l'édifice alors que je laçais mes chaussures, une vieille femme en pantalons bouffants vint me chuchoter une invitation à déjeuner. J'acceptai bien volontiers et après m'être à nouveau déchaussée, rejoignis six personnes déjà attablées dans la salle à manger prolongeant la cuisine d’un long bâtiment bas à proximité du temple.
Je pris place à la table basse sans un mot mais non sans avoir, mains jointes, buste courbé, répondu aux salutations silencieuses du moine résidant et de ses invités de passage. Le repas consistait en un bol de riz, un bol de soupe où flottaient algues et légumes et en trois ou quatre plats contenant des gimchi variés. Je reconnus le plus célèbre de tous, composé de chou saumuré dans du piment rouge, un autre de radis blancs également enrobés de piment. Il y avait les incontournables pousses de soja, les nori, feuilles d’algues pressées et grillées dans lesquelles l’on enveloppe la nourriture et aussi une pousse appelée gosari que j'aimais particulièrement ainsi préparés à l'huile de sésame et parsemés de ces mêmes petites graines. Si riz et soupe étaient nourriture individuelle que l'on plaça devant moi, les autres mets, répartis en des coupelles de bois sombre et disposées sur la longue table basse, étaient partagés par toutes les baguettes. Une coupe contenait de l'ail ayant longuement mariné dans du vinaigre de riz. Je savais ce condiment excellent mais m'abstins d'y toucher, n'ignorant pas combien il est difficile de faire parcourir à bout de baguettes, la courte distance entre la table et les lèvres à une gousse d'ail, si tendre soit-elle !
Les pèlerins, invités à la table commune se retirèrent un à un en silence, saluant respectueusement Sungjong Seunim qui attendit que j'aie terminé mon repas pour me convier à prendre le thé chez lui.
Ce « chez lui » était un quatrième bâtiment, très sobre, fait de planchettes de bois aux fenêtres en papier de riz, au toit de simples tuiles creuses couleur ardoise qui contrastait avec l'élégante toiture en pagode du temple, d’un beau bleu vernissé. Le seul décor extérieur de l’habitat du moine, était une sommaire banquette de bois permettant au visiteur de s'asseoir confortablement pour retirer ses chaussures.
Ce que j'allais trouver à l'intérieur me surprit quelque peu.
La modeste bâtisse d'environ sept mètres sur quatre n'abritait qu'une seule pièce dont le sol était recouvert du traditionnel papier huilé couleur safran. Au premier abord, le lieu me parut pratiquement vide à l'exception d'un petit bureau bas surmonté d'une étagère où s'étalait en un ordre parfait le matériel nécessaire à la calligraphie. Sur la gauche de la pièce, en dessous de la fenêtre, un téléphone, une chaîne stéréo et deux haut-parleurs, le tout à terre ainsi que, voisinant près d’un samovar, une minuscule table basse et quelques coussins plats, sièges traditionnels.
C'est là, derrière cette table de laque noire, que Sungjong Seunim s'assit, m'invitant à faire de même puis, ayant branché le samovar électrique, il se ravisa, se dirigea à l'extrémité de la pièce dont la paroi était en fait un long placard à portes coulissantes contre lequel trônaient trois statues dorées de Bouddha. Lorsque les portes du placard s'entrouvrirent, j'eus le temps de distinguer dans le rayonnage du bas une natte-futon bien enroulée, quelques vêtements, des rouleaux de papier de riz, un sac à dos. Le reste de l'espace étant réservé à des dizaines de livres bien alignés sur des étagères.
Je devinai que ces quelques mètres carrés étaient tout l'habitat du jeune moine. C'est là qu'il étudiait, qu'il recevait, qu'il priait, qu'il dormait, qu'il remplissait de caractères chinois des centaines de feuilles de papier de riz, transposant jusqu'à perfection, des sûtras, des vies de Patriarches ou bien seulement un mot, un simple mot « selon le besoin », allait un peu plus tard m'expliquer le jeune moine.
De sa bibliothèque Sungjong Seunim retira un dictionnaire, referma les portes et revint s'asseoir en face de moi. Dans ce coin « salon », tout ce dont nous avions besoin pour prendre le thé était à portée de main. Se penchant légèrement, le moine retira, d'un autre placard dissimulé dans la paroi, une boîte métallique puis une deuxième, les deux contenant des thés différents dont il fit un mélange, dosé avec attention, qu'il déposa dans une minuscule théière de terre rouge sombre.
L'eau chantonnait.
Sans hâte et sans parler, mon hôte déposa sur la table, en guise de tasses, de tout petits godets de cette même terre cuite rouge ainsi que des biscuits recouverts de graines de sésame. L'eau bouillait. Ouvrant le robinet du samovar, il remplit une première fois la théière.
Ce n'est qu'après avoir accompli avec minutie ces diverses tâches que le prieur du petit temple, non seulement se dérida mais sembla s'apercevoir de ma présence. J'avais eu tout le temps nécessaire pour observer mon hôte. Un homme jeune, quarante ans à peine. Il était très beau - peut-être même le savait-il ! - il portait comme tous les moines et moniales bouddhistes de Corée le vêtement de coton gris si souvent rencontré dans les rues de la capitale : un pantalon bouffant et une sorte de chasuble, nouée sur le côté, arrivant aux genoux. Nous étions jour férié et l'habit du prieur qui remplissait aussi les fonctions de jardinier, menuisier, maçon... était de coton ordinaire, d'un gris que de nombreuses lessives avaient pâli, ce qui n'empêchait nullement l’homme d'être superbe.
Son visage dont l'austérité était accentuée par son port de tête et surtout par son crâne rasé, s'épanouit, s'épanouit lentement et franchement puis, ayant cherché encore un mot dans le dictionnaire, il se mit à parler.
Dans un anglais limité, haché, il m'expliqua qu'il m'avait invitée pour une raison très précise : aujourd'hui était le 15 août n’est-ce pas ? Ce jour étant pour beaucoup d'Occidentaux un jour particulièrement « propice à un pèlerinage », il appréciait ma visite à son temple. Après maintes inclinaisons du buste que je m'empressai de lui rendre, Sungjong Seunim ajouta qu'il avait souvent voyagé à l’étranger et qu’ainsi certaines de nos traditions religieuses lui étaient familières tout comme la musique classique d'Occident qui était devenue « le luxe de sa vie ». Peut-être voulait-il justifier la présence surprenante d'une chaîne stéréo en ce lieu. Il y avait, posé à terre, un bon nombre de CD et de cassettes, des œuvres de Scarlatti, Schumann, Mozart, Brahms, J-S Bach, ainsi que de nombreux opéras italiens.
Le silence s'était à nouveau installé mais j'avais vécu suffisamment longtemps à Séoul pour ne pas en être gênée : en Corée, l'on ne parle pas à table.
C'est après la troisième tasse de thé prise en silence que le moine introduisit une cassette dans l'appareil et que tout à coup, la voix d'or de la soprano américaine Marian Anderson amena Schubert et son Ave Maria au cœur de Bukhansan. Mon étonnement fut si grand que l'espace d'un instant, il supplanta l'émotion qui m'avait envahie dès les premières notes de musique.
Le texte était en allemand. Mon hôte ne laissa que quelques mots s'élever et enchaîna Ava...lokitesvara... interceptant les paroles de l’Ave Maria bien connu pour les remplacer par celles du Sûtra de la Grande Compassion.
L'événement si inattendu était de taille !
La voix très belle et puissante du jeune homme ne s'arrêta qu'aux dernières notes de l'Ave Maria. Tout était tellement parfait que je ne doutais pas que Sungjong Seunim eût souvent, bien souvent, interprété ce merveilleux chant, très probablement pour lui tout seul. Quoiqu'il en soit, l'effet était remarquable comme le furent les paroles qui suivirent.
« Maria ? Avalokitesvara ? Mais c'est la même chose !
C'est l'écoute, la compassion, le pardon, la tendresse. "Votre écoute" tend les bras et est la mère de Dieu, "la mienne" qui a mille bras, donne vie à tout ce qui est bon, beau, juste, vrai. Une écoute qui, elle, a de grandes oreilles : des oreilles qui viennent jusqu'aux épaules ! », ajouta mon hôte dans un grand éclat de rire qui donna à son visage un air d'enfant heureux.
C'est d'ailleurs cette même expression qui toujours animait le visage de mon ami et plus particulièrement son regard, à chacune de nos rencontres à son temple, rencontres parfois espacées de plusieurs mois, mais qui s'étalèrent sur plusieurs années.
Sungjong Seunim, en s'exprimant de la sorte ne prétendait pas faire de l'œcuménisme, encore moins du syncrétisme, mais, ayant rencontré, peut-être même étudié, les traditions religieuses du monde occidental, il avait - aidé du silence de sa montagne - acquis une certitude.
Certitude qu’il était heureux de partager.
Aussi et depuis lors, le 15 août venu, est-ce en des directions bien différentes que mes pensées s'en vont en pèlerinage.
Différentes, vraiment ?
et se pose
c'est un nouveau venu
venu ce jour à l'aube
de la pie il a la queue
un brin de gris dans l'aile
et tout l'automne
en son jabot
il vient de Bukhansan
et m'apporte peut-être
un peu de paix
du petit temple
Paulette Spescha-Montibert
Août 1994

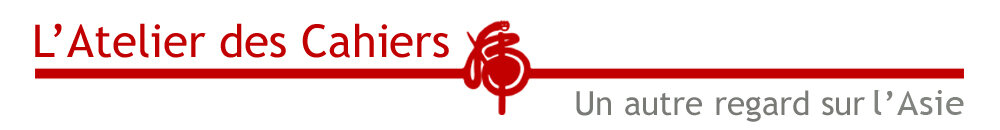

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F79%2F358075%2F84389888_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F62%2F358075%2F85537831_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F82%2F92%2F358075%2F74115559_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F62%2F358075%2F70184470_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F75%2F358075%2F36041781_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F55%2F57%2F358075%2F24216478_o.jpg)